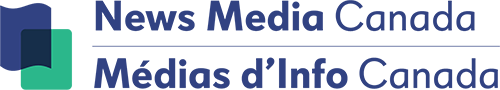BOB COX, JERRY DIAS ET EDWARD GREENSPON
Le 1er septembre, une agence du gouvernement canadien versait près de 100 millions de dollars pour soutenir l’information locale à la télévision. Aujourd’hui, il y a soudainement plus de journalistes de la télévision locale qui travaillent à préparer des articles pour plus de diffuseurs d’un bout à l’autre du pays.
Mais pourquoi cet argent est-il allé strictement à la télévision ? Pourquoi pas aux journaux ou aux publications numériques ? Ce qui importe, c’est le fait de rapporter l’information. La plateforme qui la diffuse importe peu.
Le temps est venu de se recentrer sur ce qui est important.
La réponse est une simple question de bureaucratie. La télévision est réglementée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, qui perçoit une taxe sur les revenus des distributeurs de service par câble et par satellite, et redistribue ensuite les fonds qui vont pour produire du contenu considéré comme étant d’intérêt public, comme les nouvelles télévisées. D’autres secteurs du gouvernement du Canada, soutenus par les mêmes contribuables, ont à ce jour tenu tête à toute mesure visant à aider une industrie qui joue un rôle fondamental dans notre démocratie, et qui est explicitement citée dans la Charte des droits et libertés.
La situation est loin d’être rose, et elle continue d’empirer. De plus en plus d’emplois sont perdus dans les journaux. D’après nos calculs, un emploi sur trois a disparu depuis 2010 dans notre industrie. Les fermetures de journaux dans plus de 200 circonscriptions fédérales ont dénoué les liens sociaux tissés par la diffusion d’information, qui cimente véritablement ces collectivités. Les entreprises de presse se fient à leurs journalistes pour transmettre l’information sur nos institutions démocratiques, et ce, sous forme imprimée ou électronique. Les nouvelles pousses du domaine de l’information numérique au Canada ont, à quelques exceptions près, été incapables, à ce jour, de combler le manque à gagner croissant en matière de capacité de reportage.
Le temps est venu de se recentrer sur ce qui est important. Nos médias d’information ne doivent pas baisser les bras. Nous voyons le rôle capital que jouent les grandes institutions médiatiques américaines, particulièrement le New York Times et le Washington Post, en continuant d’informer le public sur les grandes brèches qui s’ouvrent dans leur démocratie. Les relations qu’ont toujours eues les dénonciateurs avec les journalistes vont disparaître si trop de dangers menacent ces derniers.
Au Canada, la menace est plus grave que jamais parce que notre marché est plus petit. Les quotidiens canadiens ont vu plus de la moitié de leurs revenus de publicité, c’est-à-dire environ 1,5 milliard de dollars, fondre dans la dernière décennie. La majeure partie de cet argent est allée à Google et à Facebook qui, ensemble, ont hébergé plus de huit publicités numériques sur dix au Canada l’an dernier. Malheureusement, ces géants n’investissent pas dans la création de contenu de nouvelles.
Pendant ce temps, au fur et à mesure que les sources d’information vérifiables disparaissent, les fausses nouvelles, dont la raison d’être est de désorienter et de désillusionner le public, prolifèrent. Inventer des nouvelles ou déformer des faits coûte une fraction de ce qu’il en coûte pour produire de la véritable information. Que ce soit pour des raisons commerciales, partisanes, idéologiques ou géopolitiques, les fausses nouvelles sont une agression directe contre notre démocratie. Quelque chose cloche encore dans ce scénario.
Dans bien des villes, le fait d’appeler le maire le lendemain d’un conseil de ville pour savoir ce qui s’est passé la veille constitue la totalité de la couverture qui se fait des affaires municipales. Et même dans des capitales provinciales, entre les sessions législatives et la baisse du nombre de spécialistes qui couvrent les corridors du pouvoir à Ottawa, les affaires gouvernementales sont souvent passées sous silence.
Cela soulève d’épineuses questions en matière de politique publique. Personne ne veut donner aux gouvernements le pouvoir d’influencer les journalistes qui ont pour tâche de leur demander des comptes. Cela dit, Radio-Canada est à la fois un organisme subventionné par des fonds publics et un organisme indépendant – cela signifie donc que la tâche n’est pas impossible.
Deux problèmes demandent à être réglés : la nécessité d’avoir plus de journalistes sur le terrain, et celle d’innover en matière de financement afin que ceux qui produisent l’information puissent demeurer à l’affût des nouvelles habitudes de consommation de cette information.
En avril dernier, à la suite de la publication du rapport Le miroir éclaté, qui traitait de l’information, de la démocratie et de la vérité au Canada, le Forum des politiques publiques a rassemblé près de 40 médias d’information et syndicats pour proposer des solutions visant à soutenir l’embauche de journalistes et le financement de l’innovation sans toutefois sacrifier l’indépendance des médias ou fermer la porte à de nouveaux compétiteurs. Une proposition est sortie de ce processus : ajouter une nouvelle composante au Fonds du Canada pour les périodiques, qui est en place depuis longtemps déjà. Cette composante soutiendrait le journalisme de nature civique ou ayant pour mission d’améliorer la démocratie.
Ce nouveau Fonds du Canada pour le journalisme contiendrait une formule préprogrammée couvrant 30 pour cent des coûts liés à l’information dans le but d’encourager l’embauche de journalistes plutôt que leur mise à pied. Fait tout aussi important, le Fonds aurait aussi comme mission d’empêcher les gouvernements de choisir qui serait bénéficiaire de ce financement. Nous avons jeté les bases des normes de qualification de même que d’un processus d’appel indépendant du gouvernement. De plus, les entreprises ne pourraient pas utiliser les sommes aux fins de dividendes, de primes ou du remboursement de leur dette. Certains intervenants s’inquiètent avec raison d’une présence gouvernementale qui risquerait de compromettre l’existence d’une presse libre. Mais une presse sans le sou peut-elle être une presse libre ? D’autres croient qu’il est préférable d’attendre que les entreprises de presse fassent faillite pour ramasser les pots cassés. Mais une fois devant le tribunal de la faillite, ce sont les créanciers et non l’intérêt public qui sont servis, comme nous l’avons vu en 2010 : après être passée devant le tribunal de la faillite, Postmedia, croulant sous une montagne de dettes, est devenue la propriété des créanciers obligataires.
D’autres encore croient que les entreprises qui souhaitent obtenir de l’aide sont vouées à l’échec de toute façon. C’est peut-être vrai, mais les entreprises de presse et les nouvelles pousses de l’industrie devraient avoir droit à cinq ans pour prouver qu’elles peuvent demeurer à flot. L’autre choix, celui de voir de plus en plus de fausses nouvelles et de moins en moins de reportages traitant d’information véridique, va à l’encontre de ce qui sous-tend une saine démocratie.